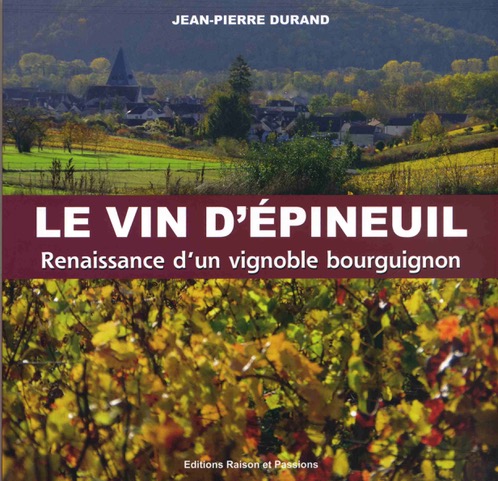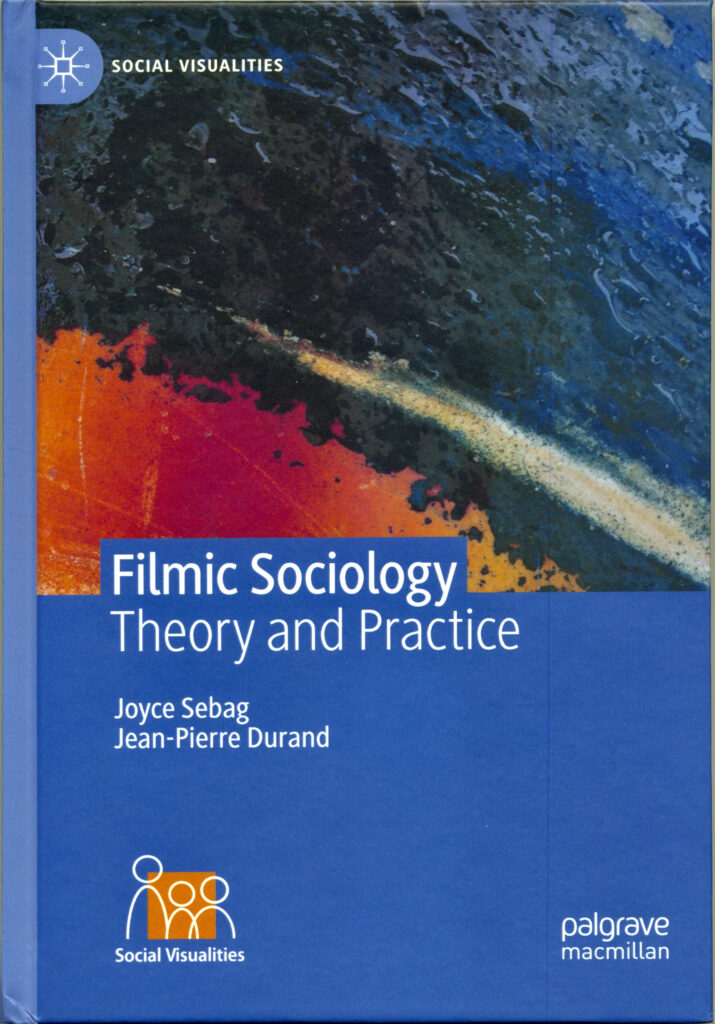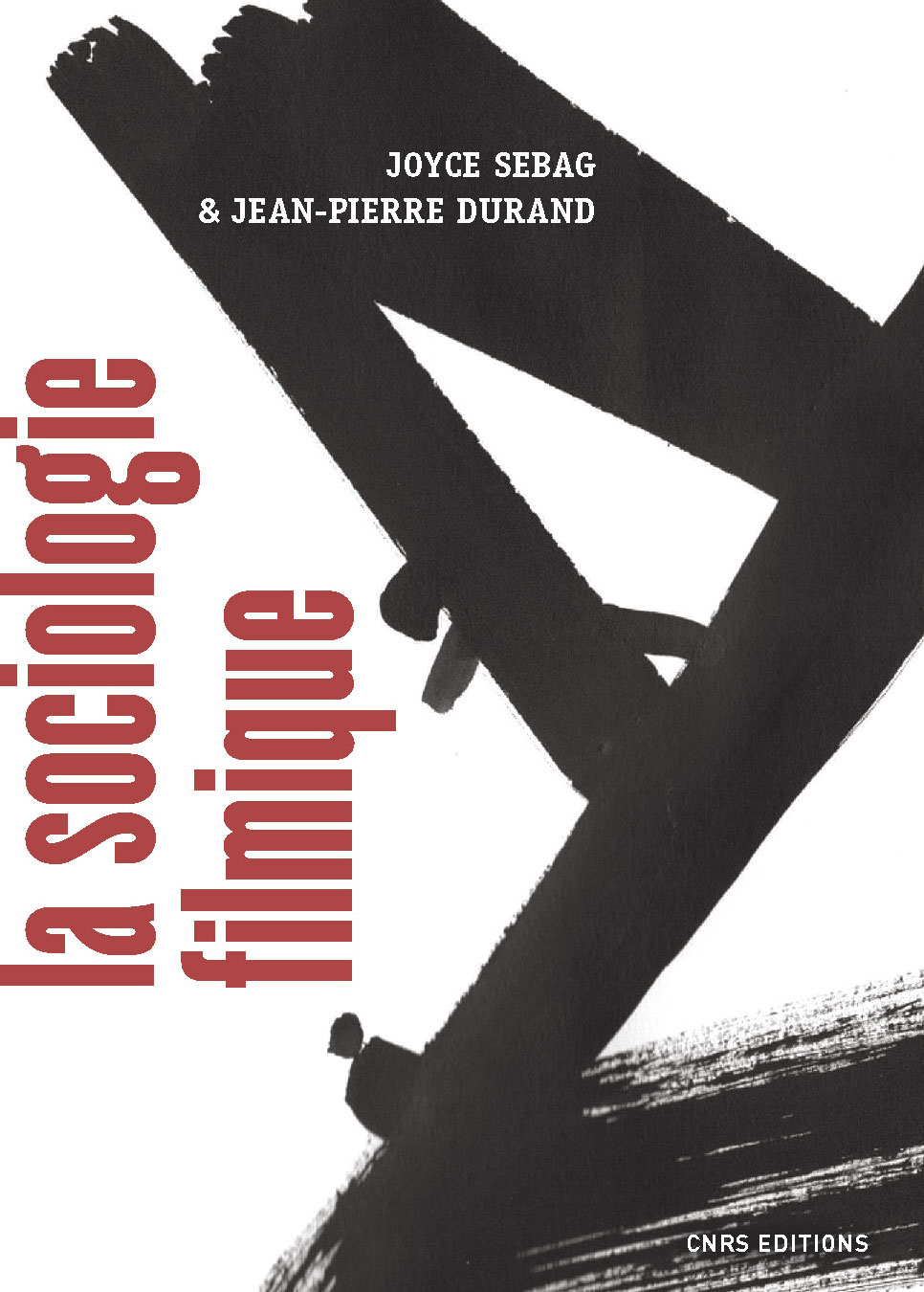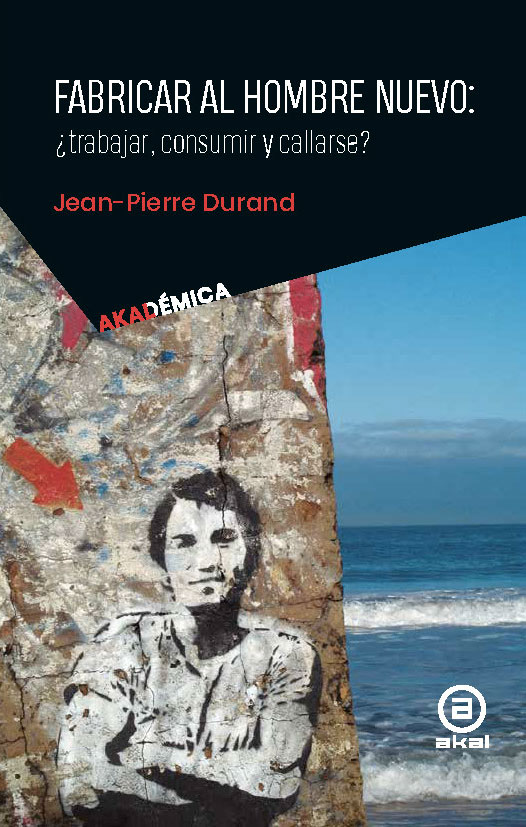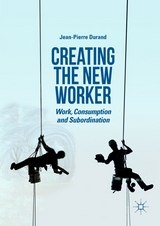Ce chapitre se propose d’interroger l’objet dominations dans le travail plutôt que de l’appliquer en tant que paradigme à un terrain particulier dans une entreprise ou dans toute autre institution privée ou publique. En effet, le concept de domination a pris de l’ampleur durant les années 1970-1980 au détriment d’autres termes comme celui d’exploitation qui a quasiment totalement disparu de la littérature sociologique. Ce chapitre est l’occasion de revenir sur ce glissement conceptuel de l’exploitation vers la domination avec des questions rarement posées : que masque-t-il ? Pourquoi un tel changement ? Quelles significations lui donner ? Pourquoi le lent remplacement du concept de rapports de classes par ceux de rapports entre genres, entre ethnies voire entre races ?
L’élucidation de ces questions conduit vers une autre problématique : pourquoi l’acceptation de l’exploitation et des dominations ? En convoquant la psychodynamique du travail, Hannah Arendt ou Michel Foucault, ce chapitre montre les limites des thèses avancées avant de déboucher sur une relecture d’Etienne de la Boétie et de Norbert Elias : la subordination n’est pas un état mais se construit dans un processus complexe, dans la durée, auquel il est difficile d’échapper et qu’il est encore plus improbable de combattre avec succès. Ce qui autorise un retour sur la situation présente pour expliquer l’acceptation de la domination et de l’exploitation, cette dernière ayant quasiment quitté la scène de la sociologie du travail, dans la phase actuelle de financiarisation du capitalisme. De nouveaux concepts permettent de relier les transformations récentes de la production des biens ou des services à cette acceptation des conditions renforcées de domination et d’exploitation. Avec quels leviers inattendus pour sortir de cette subordination ? Ou bien pour la contourner ?
1 – Glissement de concepts et changement de paradigmes
Chacun a pu observer comment la sociologie —et les autres sciences sociales— ont mis en avant un nouveau vocabulaire autour de la domination ou des conflits depuis le milieu des années 1970. Et ce, au détriment d’autres concepts antécédents essentiellement marxistes, tels que exploitation ou contradictions (même si ce dernier concept est d’abord hégélien). On pourrait ici s’interroger sur les rapports entre exploitation et domination, au travail bien sûr (c’est le plus facile !) mais aussi dans d’autres sphères voisines (famille, consommation, État, école, usage des services publics…) pour analyser cette rupture : en effet à partir des années 1970, le travail et les questions économiques perdent un peu d’importance dans les préoccupations des salariés au bénéfice des autres sphères de la vie sociale que nous venons de citer. Or, il apparaît assez nettement que les rapports sociaux entre genres, entre races, entre agents et usagers, ou bien encore les rapports entre parents et enfants, ne relèvent pas, dans les sociétés industrialisées de l’exploitation et certainement pas non plus d’analyses en termes de contradictions. Les théoriciens qui ont tenté, durant les années 1970, d’appliquer le paradigme de l’exploitation aux rapports entre homme et femme ou entre père et fils, voire entre ethnies ont du faire machine arrière tant leurs démonstrations apparaissaient peu fondées. Ici, les concepts de domination et de tensions ou mieux encore de conflits caractérisaient plus précisément les rapports sociaux dans les nouveaux champs étudiés qu’ils soient ceux du genre ou bien des cultural studies dont l’Amérique du Nord[1] s’est faite la championne avec des échos relativement faibles en Europe.
On peut regretter que les relations paradigmatiques entre exploitation et domination n’aient pas été du tout approfondies, les tenants de l’un ou de l’autre des paradigmes ne débattant pas assez de l’articulation ou mieux encore de la combinaison des deux. Or, sans hiérarchiser l’un ou l’autre de façon générale car l’efficacité de chacun des paradigmes dépend d’abord du champ dans lequel il est utilisé, il aurait été utile scientifiquement de travailler cette combinaison selon les sociétés étudiées bien sûr, mais aussi selon les champs, si l’on traite des sociétés industrialisées (ou capitalistes financiarisées, pour être plus précis aujourd’hui). Selon nous, dans l’espace de travail, les relations entre genres ou entre ethnies, ne peuvent être pensées en dehors des rapports capitalistes, sans que ces derniers ne puissent tout expliquer : il y a bien sûr toujours une spécificité des rapports genrés à l’intérieur des rapports de travail. Par exemple, le fait que dans l’industrie automobile américaine la plupart des team leaders soit des femmes ou que les contrôleurs qualité qui dispensent les points négatifs (lesquels font sauter la prime collective) dans une unité de production française, est bien un choix managérial : les dirigeants de l’usine considèrent que l’éventuelle violence des rapports nécessairement difficiles entre les catégories (team leaders/ouvriers ou contrôleuses/ouvriers) sera neutralisée par l’impossible violence physique, en retour, des hommes envers les femmes. A l’opposé de cette analyse, mais toujours dans l’importance à accorder au genre dans le travail, la faiblesse numérique des femmes dans les Conseils d’administration des entreprises et plus encore parmi les PDG restent une constante malgré les déclarations des uns et des autres…
Dans les autres espaces, les rapports entre ces deux paradigmes (exploitation et domination) sont plus difficiles à construire, qu’il s’agisse de la famille, de la religion, de la politique, de la vie syndicale ou de l’espace urbain au sens large. Il nous semble que l’on pourrait utiliser le concept de réfraction pour analyser les liens indissolubles entre rapports de domination d’une part et rapports d’exploitation ou rapports de classe d’autre part. Ce concept est certainement insuffisant puisqu’il désigne la déviation d’un rayon lumineux qui franchit la surface séparant deux milieux (exemple d’un bâton dans l’eau qui apparaît brisé) : par là-même le concept de réfraction semble traiter plus de la perception de ce rayon que de la réalité elle-même (le bâton reste droit !), mais on peut aussi penser que les questions de domination relèvent aussi largement du domaine des représentations, lesquelles sont bien aussi des faits sociaux… En attendant de trouver un concept plus « radical » qui traite des rapports effectifs (ayant des effets) entre domination et exploitation, on se contentera de parler de réfraction.
Dans la ville, les rapports ethniques, quelquefois tendus en particulier là où existe une mixité sociale plutôt subie (habitat, transports publics, lieux culturels…), sont vécus à partir de la différenciation de races et de cultures, mais au-delà, il s’agit surtout de situations objectives issues de rapports de classes ou d’exploitation : pauvreté et quelquefois misère, promiscuité, vandalisme, etc. Si on ne peut pas tout expliquer par les différenciations de classes (et donc de revenus et surtout de ressources en tous genres), les rapports de domination, avec leur corollaire les résistances et les comportements d’intolérance s’expliquent largement par les conditions objectives d’existence (dénuement, désœuvrement professionnel et culturel, etc.) tout autant que l’intransigeance vis-à-vis des différences culturelles qui sont fondamentalement liées à une faiblesse des capitaux culturels (l’incapacité à penser un autrui différent de soi), elle-même dépendante de la position de classe des intéressés. Au-delà des seules questions matérielles, il faut bien expliquer les différences de tensions sociales entre communautés entre d’une part le 7ème arrondissement de Paris ou Neuilly et certaines banlieues d’autre part où les degrés de différences ethniques sont pourtant (presque) aussi fortes. On peut d’ailleurs regretter qu’aujourd’hui certains chercheurs ou certains intellectuels brandissent le drapeau ethnique ou racial pour réécrire l’histoire récente ou en cours, partant des théories du genres pour leur substituer la race ou l’ethnie, sans référence —sauf quelquefois verbeuse— aux rapports d’exploitation et de classe.
La même problématique de la réfraction des rapports de classe sur ceux de domination qui vaut dans la ville peut s’appliquer dans les rapports familiaux (père/mère, parents/enfants), dans la vie politique ou ailleurs. Il est certainement nécessaire d’examiner finement les relations intersubjectives et les comportements sociaux dans nombre d’institutions, de milieux et de cercles pour montrer comment se combinent rapports de domination nés des caractéristiques propres de l’institution, du milieu ou du groupe —avec leurs spécificités qui donnent le ton et qui sont les plus apparentes— et celles qui proviennent indirectement de l’allocation inégale des ressources à l’intérieur de celles-ci. Or cette allocation inégale des ressources scolaires, culturelles, sociales, symboliques —pour ne rien dire ici des ressources économiques— est le résultat historique sur une plus ou moins long période et elle ne saurait se résorber en quelques décennies. Ce résultat historique tient essentiellement à la nature des rapports de production qui, de façon plus ou moins violente selon les périodes, opposent ceux qui détiennent les outils de production —ainsi que les appareils de violence pour en conserver la propriété— à ceux qu’ils emploient sous des formes chaque fois différentes. Ne pas passer par les rapports d’exploitation et de classe pour analyser les rapports de domination, même si ceux-ci ne sont que le résultat de la réfaction des premiers à travers une allocation différenciée des ressources, c’est se priver, volontairement ou non de la puissance explicative.
D’une certaine façon, c’est ce qui nous différencie des travaux de Pierre Bourdieu à qui l’on doit incontestablement, au moins en France, le succès des théories de la domination et de l’effacement des thèses de l’exploitation. Non pas qu’il n’en ait pas parlé dans certains de ses écrits. Mais par crainte de se faire cataloguer comme néo-marxiste, une large part de ses écrits à partir du milieu des années 1980 traitent de la domination sans référence, sauf implicite, au contexte socio-économique. On peut dire que ce n’était pas le cas dans ses travaux sur l’Algérie, ni même dans La distinction (1979). Mais plus tard, aussi fines qu’elles soient, ses analyses présentent des logiques institutionnelles, culturelles ou sociales qui tournent sur elles-mêmes où le méta-capital qu’est devenu le capital symbolique tend à devenir le « moteur » principal de l’action. Ensuite, l’origine sociale de ses héritiers, l’académisme de certains ou le souhait de reconnaissance immédiate des nouveaux venus ne pouvaient que perpétuer cette déformation et l’oubli quasi-définitif des rapports entre domination et rapports de classe, sauf de temps à autres sous une présentation réifiée.
Bien sûr, P. Bourdieu n’est pas le seul auteur prolifique à avoir opéré ce glissement. Quelque peu avant lui, Alain Touraine avait fait de même. Partant du travail et de sa centralité pour expliquer l’évolution des sociétés, Touraine a utilisé longtemps un vocabulaire qui semblait emprunté au marxisme (conscience ouvrière, travail, classes sociales, rapports de classes, etc.) : pourtant, une analyse rigoureuse montre que ces concepts étaient vidés de la signification sulfureuse qu’ils avaient chez Marx, alors que manquent à l’appel des concepts essentiels comme ceux d’exploitation ou de contradiction (Durand, 1989). Touraine les a remplacés par ceux de domination et ailleurs il utilise ceux de tension et de conflits pour effacer celui de contradictions.
Il faut aussi souligner la place que Michel Foucault a occupé à partir des années 1970 en renouvelant les théories du pouvoir, pour saisir l’attractivité du concept de domination dans les sciences humaines. Philosophe, très éloigné des théories économiques, M. Foucault analyse la discipline, la surveillance et le « dressage » des individus dans Surveiller et punir (1975) et fait fonctionner sur elles-mêmes les institutions qu’il étudie, bien souvent sans les ancrer dans la violence des rapports sociaux environnant et sans référence à leur raison économique d’exister. Enfin pour ne citer que quelques auteurs, c’est un peu plus tard (1995) que Julien Freund (sociologue conservateur) préface Le conflit de Georg Simmel. Ce qui se veut un renouvellement de la pensée de Hegel débouche sur une conception intégratrice du conflit aux antipodes de la thématique des contradictions de classes, mais susceptible de fonder une théorie de la domination pour cette même raison. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille renier ce bel ouvrage : il suffit d’en re-situer les résultats dans une théorie sociologique plus ambitieuse qui souhaite expliquer les mouvements de l’histoire plutôt que de rendre compte des jeux institutionnels ou des conflits secondaires. Mais, chacun l’a compris, sa publication en France —ainsi que la traduction de Sociologie et épistémologie du même auteur dans la collection des PUF dirigée par Raymond Boudon— s’inscrit dans une lutte entre paradigmes, dont celui de la domination est là pour effacer celui de l’exploitation ou celui de rapports de classes.
Si nous avons défini ainsi ce que ne sont pas les rapports de domination, par différenciation avec les rapports d’exploitation ou les rapports de classe, il nous faut en donner une définition minimale, y compris pour l’intégrer dans une théorie de l’exploitation où elle prendrait forme pour décrire les rapports sociaux au travail, puisque nous nous en tenons ici à l’espace de travail. Le concept de domination doit être entendu au sens large et peut ainsi recouvrir deux significations assez différentes. D’une part, la domination peut être entendue comme l’exercice d’une autorité souveraine : ce qui décrit tous les rapports hiérarchiques et les seules différences tiennent aux modalités d’exercice de ce pouvoir. Ici, les sources de légitimité de cette domination tendent à se multiplier, alors que les rapports hiérarchiques peuvent être médiatisés par différents dispositifs, depuis le flux tendu comme forme objectivée de management dans les machines ou dans l’organisation de la production de biens ou de services (Durand, 2012) jusqu’à l’évaluation, l’organisation par projet, les tableaux de bord, etc. D’autre part, et c’est à ces objets que la sociologie du travail doit aussi s’intéresser, les rapports de domination peuvent aussi être horizontaux… Ils ne sont pas dans les grilles organisationnelles et fonctionnelles, mais ils sont bien réels. Ces rapports de domination, qui prennent souvent la forme de conflits de sensibilités, d’intérêts, de personnalités, etc., peuvent facilement croiser des différences de genre, d’âge ou d’ancienneté, raciales ou ethniques. Parce qu’alors elles reposent sur des aspects objectifs —on dit visibles— d’appartenance des individus ou des groupes, elles prennent souvent le pas sur d’autres qualités des individus qui sont passées sous silence. Une fois de plus, il faut revenir à l’effet « rapports et appartenance de classe » dans la trajectoire socio-professionnelle des individus (ou des groupes) pour analyser les raisons ou les sources de dotations différenciées des ressources professionnelles ou, de plus en plus, comportementales. On pourra alors découvrir que l’appartenance ethnique, raciale, de genre ou à une classe d’âge n’est pas le facteur déterminant de cette allocation différenciée, mais que l’histoire individuelle ou du groupe (voir les questions d’affirmative action ou de discrimination positive) joue un rôle prédominant[2]. Voilà pourquoi la question de la domination (en dehors des rapports hiérarchiques qui établissent des situations— ou des rapports de situation) doit être aussi analysée en terme de rapports inégalitaires entre deux individus ou entre deux groupes, c’est-à-dire en termes d’inégalités de ressources scolaires, culturelles, sociales, etc. On retrouve ainsi P. Bourdieu dans l’espace de travail : selon leur trajectoire personnelle, les agents sont dotés de façon inégalitaire de capitaux scolaire et culturel (dont la faculté d’adopter le comportement attendu ou d’utiliser le vocabulaire et le ton adéquats dans une situation donnée), de capital social (le nombre et la qualité des relations sociales), de capital symbolique (ici la capacité à se projeter dans le futur, avec des ambitions correspondant aux possibles de la situation…). Que ces dispositions chez les salariés (ou les candidats à un emploi) convergent chez certaines personnes avec leurs caractéristiques de genre, d’ethnie et d’âge est avéré. Mais, d’une part ce n’est pas une nécessité, ni « déterminé » d’avance et, d’autre part, cette détention des dispositions ne tient pas (seulement) à l’appartenance de genre, de race ou à une classe d’âge, mais d’abord à la trajectoire socio-économico-professionnelle des intéressés.
2 – Pourquoi l’acceptation de la domination ?
Si à partir de maintenant, après les réserves faites quant au glissement paradigmatique accompli depuis le milieu des années 1970 en sociologie et en philosophie, nous analysons plus particulièrement les rapports de domination, au moins trois auteurs peuvent être convoqués : La Boétie avec la « servitude volontaire », Hannah Arendt avec la « banalité du mal » et plus récemment Christophe Dejours qui ajoute à la dramaturgie en parlant de « banalisation du mal ».
Selon nous, la question de la domination et de son acceptation par les salariés appelle un réexamen des situations qui tienne compte à la fois du comportement des individus et du poids des institutions. Ce travail de va-et-vient ou d’interaction est difficile à effectuer, chacun tendant à faire porter la responsabilité de l’acceptation de ces rapports de domination sur un seul élément ou une seule partie. Dans un entretien récent avec Jean Ferrette (non publié à ce jour), C. Dejours accuse les syndicats de refuser d’analyser le phénomène de domination en s’en tenant à une dénonciation du « système » : « Les systèmes fonctionnent par eux-mêmes avec une espèce de génie endogène qui fait qu’un système a une tendance spontanée à se maintenir, s’entretenir, se développer. C’est une théorie qui rend compte d’un certain nombre de phénomènes et a bénéficié de l’apport des biologistes qui ont montré que cette autopoies, cette autoproduction, autoreproduction, autotransformation, est présente dans le vivant. (…) Ce qui est vrai au niveau biologique est faux du point de vue social et politique. Les systémiciens qui viennent après Luhmann sont toujours au service du triomphe d’une déresponsabilisation, et de l’opportunisme. Puisqu’on ne peut rien y faire, il est erroné de se battre contre, donc il faut s’adapter ».
D’où la conclusion : « Ça veut dire qu’aucun système, aucune armée, aucune organisation, aucune entreprise, aucune administration, aucun État ne fonctionne par lui-même, par le pseudo-fonctionnement d’un système. (…) Chacun est individuellement engagé. Même ce système individualisé des performances qui nous détruit les uns les autres ne marche pas tout seul, c’est nous qui le faisons marcher. Nous sommes impliqués en tant qu’exécutants, qui ne sommes jamais seulement des exécutants puisque nous apportons notre zèle. Du côté des chefs, du management, de la direction, la responsabilité est engagée. Ils ne sont pas des “transmetteurs d’ordre”. Et le niveau des responsabilités n’est effectivement pas le même entre celui qui est en bas et celui qui est en haut. (…) Quand vous acceptez une position de management dans l’éducation nationale ou dans l’appareil d’État vous ne pouvez pas dire “je ne suis pas d’accord mais je le fais quand même “. La responsabilité est totalement engagée. Il y a donc un problème politique. Le génie du système n’est pas endogène mais fondamentalement dépendant de la contribution que nous apportons à son succès, en acceptant de le subir ou de le faire subir. Il n’y a pas de fatalité. Comme les gens sont engagés par leur intelligence, ils engagent leur liberté et leur capacité de penser dans ce système qui nous opprime et d’une certaine manière nous détruit. C’est à ce niveau là que se trouvent les ressorts de l’action ».
Cette proposition du « tous coupables » qui revient à donner à chacun la responsabilité du tout, malgré les détours effectués par le travail sur la subjectivité de chacun, propre au psychiatre ou au psychanalyste, revient quelque part à redonner toute sa puissance au paradigme de l’agréation des comportements individuels pour expliquer les phénomènes sociaux, cher à l’individualisme méthodologique. Non pas que nous ayons ici des individus rationnels et calculateurs comme chez Raymond Boudon[3], mais les sujets de C. Dejours, sans capacité d’action —puisqu’ils acceptent majoritairement la domination—, consentent par leur immobilisme et, d’une certaine manière, organisent leur propre domination par autrui ou par l’institution. Cette culpabilisation généralisée à laquelle conduit cette thèse n’est-elle pas aussi démobilisatrice que celle du « système » responsable de tous les maux ? Ne risque-t-elle pas de conduire à l’inaction à son tour ? De plus, est-elle tenable ? L’auteur lui-même n’est-il pas en position de dominant dans son laboratoire de recherche ou au CNAM, ou bien encore dans l’institutionnalisation de la « psychodynamique du travail » avec des centaines d’adulateurs dans les amphithéâtres ?
Hannah Arendt propose une autre démarche pour répondre à la question posée aux Juifs victimes du nazisme dans les ghettos —ou dans le fonctionnement des camps d’extermination—, au cours du procès d’Eichmann : « Pourquoi ne vous êtes-vous pas révoltés ? ». Sa thèse, bien sûr insupportable et certainement discutable[4] est celle de la coopération des Juifs et plus particulièrement de leurs représentants à leur propre extermination. Dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, H. Arendt (2002 [1963]) écrit : « Les juges mentionnèrent deux fois la question de la coopération ; le juge Yitzak Raveh arracha à un témoin qui avait fait de la résistance l’aveu selon lequel la “police du ghetto“ avait été “un instrument entre les mains des assassins“ ainsi qu’une reconnaissance de “la politique de coopération du Judenrat avec les nazis“ ; et le juge Halévi découvrit, à partir du contre-interrogatoire d’Eichmann, que les nazis considéraient la coopération des Juifs comme la pierre angulaire même de leur politique juive » (p. 238). Et plus loin : « Partout où les Juifs vivaient, il y avait des dirigeants juifs, reconnus comme tels, et cette direction, presque sans exception, a coopéré, d’une façon ou d’une autre, pour une raison ou une autre avec les nazis » ( p. 239). Elle va même jusqu’à affirmer que s’ils n’avaient pas été organisés, selon les calculs de Freudiger, beaucoup plus auraient pu échapper au génocide : « À Amsterdam, comme à Varsovie, à Berlin comme à Budapest, on pouvait faire confiance aux responsables juifs pour dresser les listes des personnes et de leurs biens, pour obtenir, des déportés eux-mêmes les fonds correspondant aux frais de de déportation et d’extermination, pour recenser les appartements lissés vides, pour fournir des forces de polices qui aidaient à l’arrestation des Juifs et les mettaient dans les trains, jusqu’à ce que, geste ultime, ils remettent dûment les fonds de la communauté juive aux nazis pour confiscation finale. Ils distribuaient les étoiles jaunes et parfois, comme à Varsovie, “la vente de brassards devenait un véritable commerce ; on avait le choix entre les brassards ordinaires en toile et les brassards en plastique, de meilleure qualité et lavables“. En lisant les manifestes qu’ils rédigèrent, inspirés mais non dictés par les nazis, nous pouvons encore sentir à quel point ce nouveau pouvoir leur plaisait. Comme le formulait la première déclaration du Conseil de Budapest : “Le Conseil central juif s’est vu accorder le droit de disposer sans réserve de tous les biens spirituels et matériels juifs et de toute la force de travail juive.“ Nous savons comment se sentaient les responsables juifs lorsqu’ils devinrent des instruments de meurtre —comme des capitaines “dont les navires allaient couler et qui réussissaient à les ramener à bon port en jetant par dessus bord une grande partie d’une précieuse cargaison“ ; comme des sauveurs qui “en faisant cent victimes, sauvaient mille personnes, en en faisant mille en sauvaient dix mille“. » (p. 228-229). Elle montre aussi comment ceux qui dressaient les listes tentaient d’échapper au sort des autres au nom « de principes sacrés », à savoir sauver ceux qui avaient travaillé toute leur vie pour la communauté.
Dans cet ouvrage, la thèse n’est plus seulement la responsabilité de tous comme chez Dejours, mais la responsabilité des dirigeants, des cadres, de l’élite. Nous pouvons l’exprimer comme la thèse des relais qui, pour échapper à l’extermination, coopèrent avec les nazis. Autrement dit, c’est la mise en cause d’un élément tiers, entre les nazis et les victimes, à laquelle procède H. Arendt : ce tiers est soit élu, soit autoproclamé, soit désigné par une procédure propre à l’institution religieuse. Mais dans tous les cas, il est accepté et surtout reconnu par les membres de la communauté. Et parce qu’il est reconnu et ainsi légitimé, il possède l’autonomie pour coopérer avec les nazis, y compris pour accomplir le moindre mal (cf. ci-dessus la citation de H. Arendt) ou quelquefois pour écarter le danger qui le menace personnellement, dans sa chair ou dans sa famille. Parce que le relais est porté par la communauté il est le meilleur intermédiaire des nazis pour qu’ils accomplissent leurs desseins.
Cette thèse du tiers-relais est logiquement tenable, mais peut apparaître quelque peu simplificatrice, en premier lieu parce que ces dirigeants n’ont pas été désignés par leurs mandants pour mener à bien le projet nazi, mais pour organiser cultuellement, socialement et culturellement la communauté, en temps de paix. De plus, cette thèse ne dit mot de l’acceptation de la situation ou de la coopération des membres de la communauté qui avaient quelques connaissances même très imparfaites de ce qui les attendaient. Ici, le plus extraordinaire est que la plupart des futures victimes savaient (de façon floue il est vrai), alors qu’en même temps elles refusaient d’y croire, de penser possible une telle décision humaine. D’une certaine manière l’attirance de la vie ou de la survie les conduisait à rester, par exemple en Allemagne (Feuchtwanger, 2013), parce que tout départ comportait tellement d’incertitudes qu’il valait mieux rester dans la communauté.
Si H. Arendt traite plus de la question de l’acceptation d’une situation qui n’a rien à voir avec la domination ordinaire le lecteur en voit la proximité : il n’y a pas de domination sans l’agrément de celle-ci. Autrement dit, la problématique des raisons de l’acceptation converge par là-même avec la problématique de la domination. Pour La Boétie la domination de la population par le tyran et son acceptation relèvent de la servitude volontaire. Laquelle se fonde sur la coutume (transmise par l’éducation) et sur la lâcheté ou l’abêtissement dus aux jeux et aux croyances que s’invente le peuple. Mais la cause principale de la servitude volontaire réside dans la démultiplication du pouvoir à travers laquelle le tyran s’entoure de quelques chefs qui recrutent d’autres individus à leur tour maintenus dans la dépendance jusqu’à ce que des millions lui soient liés. A la place du tiers-relais d’H. Arendt, raison de l’acceptation sociale du nazisme, La Boétie propose une explication en termes de processus : le tyran délègue quelques parcelles de son pouvoir à des personnalités qui dépêchent à leur tour celles-ci à d’autres chefs subalternes de sorte que tout un chacun est lié aux autres jusqu’au plus bas de la hiérarchie sociale. Plus encore, la construction tient facilement —c’est en ce sens qu’il s’agit d’une servitude volontaire— parce que chacun accepte et se contente du peu qu’il obtient dans cette allocation des ressources (pouvoir et avantages qui lui sont liés) : il accepte la domination des uns (et donc du tyran) parce qu’il domine les autres et en retire quelques gratifications, mêmes mineures. D’où cette formule assourdissante : « le tyran asservit les sujets les uns aux moyens des autres, et est gardé par ceux desquels, s’ils valaient quelque chose, il se devrait garder. » (La Boétie, 2003 [1548], 42). La fin de la citation nous replonge dans la question des ressources scolaires, culturelles et sociales dont dispose la population qui permettent ou non de maintenir le tyran en place ; on pourrait aussi y lire l’espoir que l’éducation soit le meilleur remède à la tyrannie et un tremplin vers la démocratie.
Ce qui apparaît novateur chez La Boétie, même si le terme n’est pas utilisé et ne le sera que beaucoup plus tard, c’est la prise en compte du processus[5] par lequel s’établit la domination (la servitude) et la tolérance de celle-ci (son caractère volontaire qui est plus actif que passif). Pour ce qui nous intéresse ici, à savoir les dominations dans le travail[6], cette réflexion nous conduit à écarter les explications en terme d’individus ou de système. L’explication systémique est trop univoque pour être acceptable puisqu’elle décharge tous les acteurs d’une quelconque participation en faisant des êtres seulement agis et sans conscience. A l’inverse, l’explication par la seule responsabilité individuelle conduit à penser que chaque encadrant est un « salaud potentiel » et à transformer tout un chacun en kapo comme le déclarait C. Dejours dans article du Monde de février 1998 et comme cela transparaît dans Souffrance en France.
Notre proposition diffère de ces deux approches et prend en compte les transformations des entreprises, de l’organisation du travail et des modes de management en comparant ce qu’ils étaient en général dans les années 1960-70 (en dehors de quelques cas bien connus comme l’industrie automobile par exemple ou les ateliers du tertiaire de masse) et ce qu’ils sont aujourd’hui. En effet, quand une majorité d’individus (encadrants mais aussi collègues de travail dans des fonctions d’exécution) adoptent aujourd’hui des positions individualistes (ou plutôt égocentrées), du chacun pour soi, de non-respect d’autrui, voire de domination sur les pairs, autant de comportement devenus assez fréquents alors qu’hier régnaient plus d’entraide, de soutien et de démarches collectives, on ne saurait tenir ces salariés pour seuls responsables des transformations advenues. S’en tenir à la seule subjectivité des acteurs qui ont adopté ces attitudes nouvelles —il faudrait prendre aussi en compte la progressivité du changement qui s’échelonne sur plusieurs décennies, voire générations— revient quelque part à soutenir qu’ils avaient des dispositions rentrées, latentes pour de tels comportements égocentrés. C’est-à-dire aussi attribuer aux hommes une sorte de permanence ou de qualités intemporelles qui s’exprimeraient quand les conditions le permettent. Et pourquoi pas une « mauvaise nature » de l’homme : ce serait alors revenir à une conception « essentialiste » de l’homme qui n’a rien à voir avec les acquis de la sociologie ou avec ceux de la psychanalyse.
La question posée est celle des transformations sociales et des conditions d’exercice de l’activité de travail avec le développement de pressions, d’obligations et de contraintes nouvelles. On comptera parmi celles-ci les exigences du flux tendu généralisé à la quasi totalité des activités industrielles et de services, l’évaluation individuelle qui observe la conformité des comportements par rapport à ceux attendus, l’individualisation des primes et des gratifications, etc. Toutes ces innovations ne proviennent pas d’un « système », mais d’une conjonction historique entre la crise de l’accumulation du capital à la fin des Trente Glorieuses, de l’audience accrue de l’idéologie libérale pour ne pas dire de son monopole (après 30 années de règne d’une pensée plus « collective ») et d’une internationalisation intensive des marchés. Autrement dit, la culpabilisation ou la mise en cause des individus est vaine car elle ne tient pas compte de l’histoire, de l’évolution de l’encadrement des individus, des contraintes imposées, du travail fait sur la subjectivité des salariés à travers des systèmes subtils d’intéressement, de contentement au travail. Même si les diverses enquêtes rapportent le durcissement du travail, les salariés y déclarent aussi certaines satisfactions à travers le fait que leur travail est plus attrayant, plus intellectualisé —ce qui est une nécessité dans la plupart des postes en raison du suivi des activités à travers un terminal informatique— avec une certaine responsabilisation des individus.
Ainsi, la démarche processuelle doit nous permettre de comprendre comment les individus sont travaillés par leur environnement immédiat ou plus généralement par la société (valeurs morales). Des individus-éponges —pour reprendre la terminologie de Jean Georges Padioleau (1986) mais en en inversant l’usage— peuvent adopter instantanément les nouvelles valeurs individualistes diffusées par l’idéologie libérale, mais c’est aussi parce que ce sont les plus prégnantes à un moment donné : ce sont à la fois les impasses (provisoires ?) des paradigmes accordant la primauté au collectif, mais aussi, au cœur du travail, d’éventuels possibles offerts par une réorganisation du travail qui prétend responsabiliser de plus en plus les salariés ou élargir leur autonomie (y compris parce que le capitalisme contemporain maîtrise mieux les modes de commandements en les adoucissant pour les rendre plus supportables). Par là-même, la servitude et l’asservissement sont récompensés[7], donc acceptables et bien souvent acceptés. C’est cette même démarche processuelle qui nous a conduit à adopter le concept d’implication contrainte (Durand, 1992), parallèle à celui de La Boétie, mais plus proche du vocabulaire du travail et de l’entreprise. Dire qu’il y a volontariat ou implication signifie que les salariés perçoivent un avantage à s’engager dans leur travail : ce peut être plus d’autonomie, un travail plus intéressant, une reconnaissance par les pairs, par la hiérarchie ou par la famille, voire une sortie des exigences du flux tendu en entrant dans la filière hiérarchique. Ce sont autant de rémunérations symboliques qui mobilisent les salariés. Mais en même temps, cette mobilisation, cette implication, ce volontariat sont devenus obligatoires : ce sont les nouvelles contraintes du flux tendu ou bien encore celles de la loyauté et de l’allégeance à la direction de l’entreprise ou à la hiérarchie.
Le concept d’implication contrainte rend compte de la situation contradictoire fait aux salariés qui les conduit à adopter des comportements individuels non moins contradictoires. Tout en bas de l’échelle socio-professionnelle, les détenteurs de contrats précaires souhaitent être « titularisés » (c’est-à-dire avoir un CDI) et les anciens tentent d’échapper à une mise à l’écart prématurée : ces deux catégories qui peuvent constituer plus de la moitié du personnel de certains services ou ateliers adoptent les normes comportementales requises et se mobilisent par nécessité. Juste au-dessus d’eux et bien au-delà, la majeure partie des salariés-évaluateurs sont évalués à leur tour et doivent adopter les codes attendus pour faire face à leur évaluateur dans de bonnes conditions. Nombre de salariés aspirent à de meilleurs revenus, à des tâches plus intéressantes et à une reconnaissance sociale. Qui pourrait blâmer autrui qui cherche une visibilité sociale et un capital symbolique accrus puisque chacun use des mêmes stratégies ? Tel est aujourd’hui le fondement du régime de mobilisation qui associe étroitement conditions objectives (les exigences du flux tendu) et conditions subjectives (l’évaluation individuelle qui fait intérioriser les codes la nouvelle normalité). C’est la conjonction de la malléabilité des individus (rendus toujours plus dociles par les conditions économiques de concurrence interindividuelle et par l’idéologie libérale qui conforte une perception individualiste du monde) et des modalités toujours plus sélectives de recrutement et de maintien dans l’emploi qui font des rapports de domination de plus en plus violents —entre pairs et/ou dans le commandement— la nouvelle banalité des relations de travail[8]. Ce qu’il s’agit de montrer aussi, c’est la nature renouvelée de cette conjonction —qui a bien sûr toujours existé puisqu’elle est intrinsèque au rapport salarial— due aux transformations du capitalisme, devenu beaucoup plus exigeant quant au degré d’exploitation de la plupart des salariés, en particulier parce que l’économie réelle doit atteindre des résultats comparables (entendons des taux de profits) à ceux de l’industrie financière — bien souvent en y contribuant d’ailleurs.
3 – Les résistances aux dominations : vers quelles transformations de la relation salariale ?
Nous avons privilégié ici le pourquoi de l’acceptation des dominations, en décortiquant les processus d’imposition-contentement que recouvrent les concepts de servitude volontaire en général et d’implication contrainte dans les situations de travail, plus précisément. Ces concepts paradoxaux ouvrent ou contiennent nécessairement une réflexion sur les résistances à la domination : l’implication ne peut être pensée sans la désimplication, ni sans le découragement face à la contrainte quand celle-ci rend impossible le contentement au travail, ou la reconnaissance par les autres. Autant de situations où les dominations sont trop fortes pour rendre acceptables les conditions du travail (la « qualité du travail » selon Yves Clot, 2010). Les différentes intensités de résistance à la domination dépendent du degré de celle-ci et des capacités des intéressés à y faire face. Autrement dit les résistances dépendent en grande partie de l’état ou des qualités de la relation salariale[9]. C’est pourquoi leurs analyses donnent lieu à autant de débats, entre ceux qui minimisent ces résistances et ceux qui en exagèrent la portée jusqu’à prédire la révolte généralisée (proche).
La plupart des salariés —et des travailleurs en général— connaissent ou ont vécu des moments de désillusion, de rancœur ou de révolte qui les conduisent à adopter des attitudes un peu moins coopératives. D’autres s’engagent plus explicitement dans un discours, voire des actes de résistance, jusqu’à ce que certains s’opposent aux directions à travers l’action syndicale et/ou politique[10]. Autrement dit, si des attitudes ou des actes de résistance concernent (presque) tous les travailleurs, une minorité les transforme en une action militante. L’action collective restant incertaine, parce que largement combattue par les directions, les « résistants » sont aujourd’hui de plus en plus confinés, au sens politique du terme, c’est-à-dire enfermés ou isolés pour éviter toute contagion des autres salariés. De plus, la résistance s’avère vaine pour les plus démunis, comme les salariés sans qualification (en particulier les jeunes sans qualification), les seniors qui sont physiquement fatigués (ouvriers) ou qui coûtent trop cher (cadres et ingénieurs), les femmes qui reviennent travailler après avoir éduqué leurs enfants, etc. Toutes ces catégories n’ont guère la possibilité « d’être les acteurs de leur carrière » comme le discours managérial les y incite, ni bien sûr de battre en brèche la domination globale et financière qui les a marginalisées.
Si l’on s’intéresse précisément aux formes de résistances aux diverses dominations, on en perçoit la très grande variété qui, en général, ne les remettent pas en cause, s’en accommodent, pourrait-on dire, pour mieux les contourner et adapter les comportements aux contraintes[11]. Par exemple, la simulation de loyauté aux managers est devenu un phénomène courant qui a des effets certains : cette simulation empêche toute prise de position ou toute participation à l’expression du mécontentement : elle participe de la servitude volontaire. En ce sens la simulation est aussi un moyen de maintien de l’ordre, en particulier par l’imitation qu’elle suscite : si la plupart des salariés adoptent cette attitude, c’est le conformisme qui l’emporte sur toute contestation. Mais la simulation révèle aussi une crise de confiance qui peut fragiliser la production de biens et de services, à un moment donné, par exemple lors d’une crise.
Cette simulation de la loyauté a en général un effet néfaste au bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’administration, du point de vue managérial. Il n’est pas rare de rencontrer des salariés qui avouent passer entre un cinquième et un quart de leur temps de travail à renseigner des tableaux relatifs à leur activité : car près de la moitié de ce temps est consacré à mettre en adéquation les chiffres avec les données cibles ou les attentes présumées de la hiérarchie, sachant que la mise en cohérence des divers documents n’est pas une mince affaire. Nous avons pu aussi observer que plus les salariés ont des responsabilités, plus leurs salaires sont élevés, plus ce temps s’allonge.
Jusqu’où ces simulations ou ces truquages, ces travestissements, ces fardages du réel compromettent-ils le bon fonctionnement de l’entreprise ? Qu’en connaissent les Directions générales, sachant qu’elles peuvent aussi s’appuyer sur ces données erronées pour fournir une image falsifiée de la réalité au PDG et aux actionnaires ? Chacun a le souvenir d’Enron dont la direction alla jusqu’à subvertir les commissaires aux compte pour se maintenir : il en fut de même pour Parmalat en 2003, mais ce sont là des situations qui restent exceptionnelles.
L’analyste peut aussi interroger le monde du travail et les dominations : n’y aurait-il pas des situations de travail où l’on assiste à des dépassements ou à des renversements des dominations, c’est-à-dire des situations où la résistance individuelle, collective, ou bien la simulation, ou bien la rareté de certaines compétences ou dextérités instaurent de nouvelles « relations de pouvoir » mettant à bas les dominations ? S’agirait-il d’une réduction ou d’une fin (provisoire ?) des dominations à travers leur propre fragilisation ? Est-ce concevable au moment où la crise économique et financière attaque frontalement l’emploi et le travail ?
A travers la perversion possible, ou déjà rencontrée des dispositifs de gestion, n’y a-t-il pas des leviers décevables par la sociologie du travail qui conduiraient à de nouvelles transformations du travail favorables aux salariés ? Il s’agirait d’une sorte de revanche des acteurs dans le travail sur les systèmes de travail et sur ses finalités dans le capitalisme contemporain.
Bibliographie citée
Arendt Hannah (2002 [1963]), Eichmann à Jerusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard/Folio.
– Clot Yves (2010), Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psycho-sociaux, Paris, La Découverte.
– Delzescaux Sabine (2001), Norbert Élias. Une sociologie des processus, Paris, L’Harmattan.
– Durand Jean-Pierre, Paul Stewart, Juan José Castillo (1998), L’avenir du travail à la chaîne, Paris, La Découverte.
– Durand Jean-Pierre (2011), « Quelles violences dans les processus d’évaluation » in M. Dressen et J.-P. Durand, La violence au travail, Toulouse, Octarès..
– Durand Jean-Pierre (2012), « Le statut présent de l’évaluation : un analyseur du changement de système productif ? », Revue Espaces Marx, 2ème semestre.
– Durand Jean-Pierre (2012), La chaîne invisible. Travailler aujourd’hui : du flux tendu à la servitude volontaire, Paris, Le Seuil.
– Feuchtwanger Edgar (2013), Hitler mon voisin. Souvenirs d’un enfant juif, Neuilly sur Seine, Editions Michel Lafon.
– Foucault Michel (1975), Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
– Goussard Lucie (2011), L’organisation par projet. Enquête dans deux établissements des industries automobile et aéronautique, Thèse de Sociologie soutenue au Centre Pierre Naville, Université d’Evry.
– La Boétie Etienne (de), (2003 [1548]), La servitude volontaire, Paris, Arléa.
– Padioleau Jean Georges (1986), L’ordre social. Principes d’analyse sociologique, Paris, L’Harmattan.
– Simmel Georg (1995), Le conflit, Paris, Circé/poche.
– Simmel Georg (1981), Sociologie et épistémologie, Paris, PUF.
– Walzer Michael (1998), Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard.
[1] On lira avec intérêt les réflexions de Michael Walzer (1998) sur ces questions, puisqu’elles prennent le contrepied des idées généralement admises.
[2] Pour être complet, il faudrait traiter ici la question des transfuges sociaux, y compris pour expliquer à ceux qui contestent cette analyse que l’exception peut confirmer la règle. Car à y regarder de près, la plupart des situations et des succès (ou des échecs) des transfuges sociaux peut s’expliquer par une « anomalie » trajectorielle qui les place dans une nouvelle cohorte ; laquelle anomalie n’est guère visible pour celui tente d’expliquer le phénomène du transfuge.
[3] Cf. pour un exposé des thèses de l’individualisme méthodologique et sa critique de fond, Durand, 1989.
[4] Une importante littérature reprise et débattue dans la Présentation de l’ouvrage par Michelle-Irène Brudny-de Launay met en cause l’argument de coopération des représentants de la communauté en rappelant l’importance de la résistance juive dans les pays occupés par l’armée nazie. Nous n’entrons pas dans ce débat ici, malgré son importance : la thèse d’Hannah Arendt vaut en tant que fondatrice d’un paradigme contribuant à expliquer l’acceptation de la domination, quoiqu’il y ait une résistance à celle-ci, car cette résistance reste en général minoritaire dans une population ou une catégorie sociale dominée.
[5] Ici il nous justifier ce terme en revenant sur son renouveau actuel, y compris à travers une relecture de Norbert Elias. En effet, si les lecteurs français perçoivent dans le terme de configuration l’une des grandes trouvailles d’Elias il est probable que ce soit en raison d’une mauvaise traduction. Selon Sabine Delzescaux le terme de configuration enferme l’objet d’étude dans une situation, le fige, alors que Norbert Elias privilégie le mouvement et le changement. D’où la proposition de remplacer le concept de configuration par celui de démarche processuelle (Delzescaux, 2001).
[6] Comme déjà dit, nous ne revenons pas sur la situation historique qui instaure l’exploitation, laquelle signifie aussi le développement du rapport salarial qui est lui-même un rapport de subordination à l’employeur et aux chefs auxquels il délègue une partie de ses pouvoirs. L’acceptation présente de cette situation peut toutefois relever de l’objet étudié ici sans être au cœur de celui-ci.
[7] On ne parle pas ici des fermetures de sites qui montrent à chaque fois la désespérance et la fin d’un combat : les salariés se battent pour de meilleures primes de licenciement et conditions de reclassement, plutôt que pour le maintien en activité des sites !
[8] Le lecteur aura compris que ce chapitre ne traite pas ici des troubles socio-psychiques mais qu’elle en établit les fondements concrets à travers les rapports de domination.
[9] On dissocie la relation salariale du rapport salarial (et des relations de travail) ; la relation salariale est une configuration ou un arrangement de plusieurs éléments qui concourent à mobiliser les salariés au travail : le système de rémunération, le mode de commandement, l’organisation du travail, les relations professionnelles, lesquels dépendent bien sûr des phénomènes contextuels tels que le marché du travail, le système de formation, l’état du syndicalisme, etc. (Voir pour un exposé théorique, Durand et al, 1998, 13).
[10] Lucie Goussard (2011) a fait une classification assez rigoureuse et imagée de ces attitudes vis-à-vis des difficultés rencontrées dans le travail et face aux dominations : par ordre croissant de capacité d’action contre les dominations, elle propose les catégories suivantes : les engagés (en général jeunes et diplômés dont la loyauté est récompensée), les réservés (qui ont compris que les promesses ne seront pas tenues), les déçus (en retrait suite à une déconvenue irréversible) et les contestataires (en général des syndicalistes). Si les engagés et les contestataires représentent chacun moins de 10 % d’un ensemble de salariés, ceux qui s’accommodent plus ou moins bien de leurs conditions de domination au travail constituent une très grande majorité des salariés —et certainement des travailleurs en général.
[11] Ce qui ne veut pas dire que l’effet de cette évaluation et que cet arrangement avec celle-ci soit neutre. Bien au contraire, on peut montrer que le principal effet de l’évaluation individuelle n’est ni l’avancement, ni l’affectation de primes, mais l’intériorisation ou l’incorporation des nouvelles normes de fonctionnement, celles-ci jouant le rôle d’auto-encadrement de la pensée et d’autosuggestion des bonnes réponses et des bons comportement s à adopter (cf. Durand, 2011 et 2012).