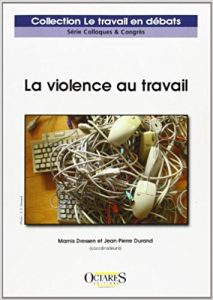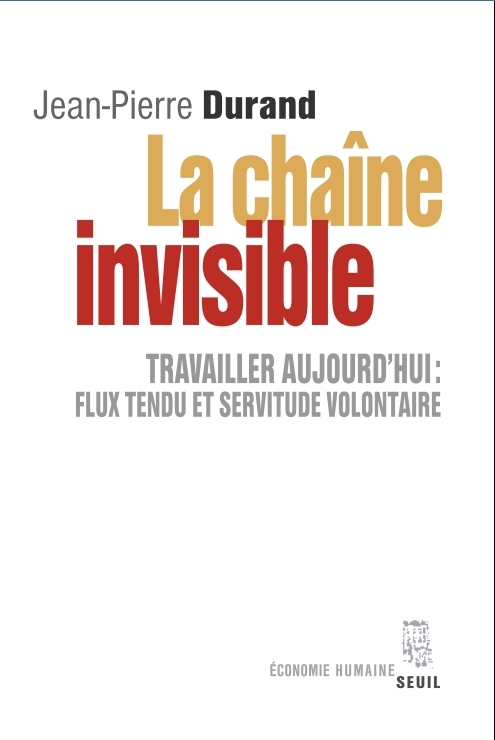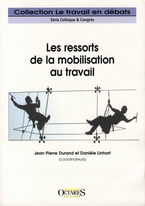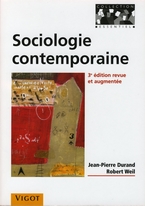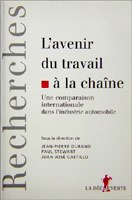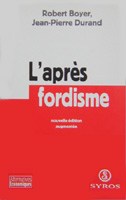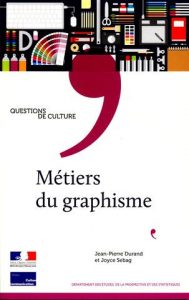
Le graphisme est affaire de mots et d’images. Pourtant, alors que la communication visuelle a envahi nos sociétés contemporaines, le graphisme est paradoxalement devenu invisible aux yeux du grand public. Au croisement de plusieurs disciplines artistiques comme la photographie, la peinture, le cinéma, le design d’objet ou encore l’architecture, l’activité reste mal identifiée. À cela plusieurs explications possibles : la multiplicité des supports de création, de l’imprimé au web design, la diversité des statuts d’emploi et jusqu’à la diversité des termes le désignant, du graphisme au design graphique.
A partir des témoignages de jeunes graphistes en cours de professionnalisation et de graphistes renommés dans leurs différents domaines de création (affiche, animation 3D, publicité…), l’ouvrage présente la profession dans sa diversité de situations d’emploi – salarié ou indépendant, travaillant pour le secteur institutionnel ou le secteur commercial, pour le support imprimé ou animé – et décrit les enjeux auxquels elle est confrontée : adaptation aux technologies numériques qui tend à créer un fossé générationnel, diversité des formations, difficulté d’insertion dans un marché du travail où le talent et la notoriété laissent peu de place à la génération entrante, pourtant de plus en plus nombreuse depuis la fin des années 1990.
Au-delà des différences liées à l’exercice du métier et en dépit de phénomènes générationnels, des trajectoires convergentes sont identifiées, qui rappellent que l’histoire du graphisme est avant tout une histoire de regards : sur le monde, la société, la cité.